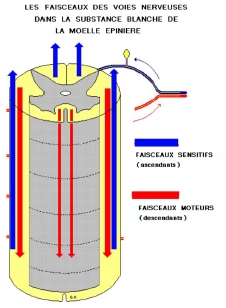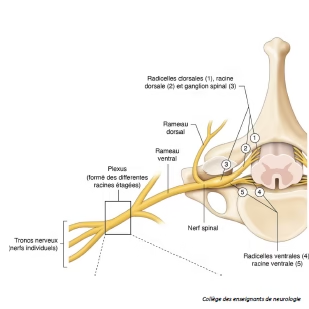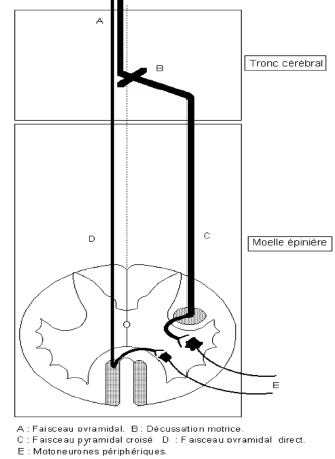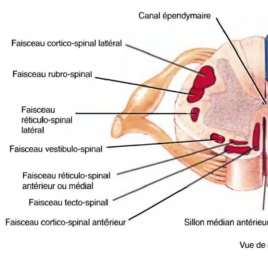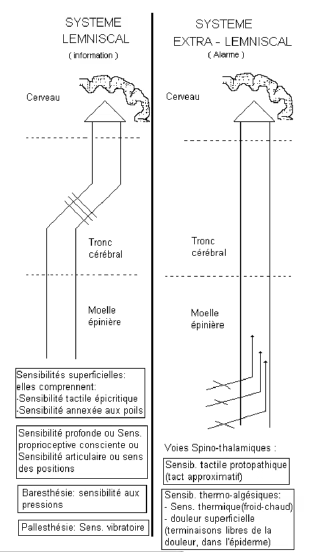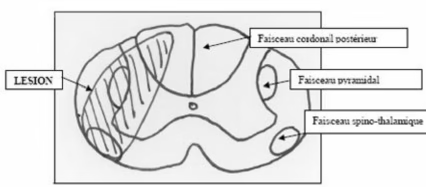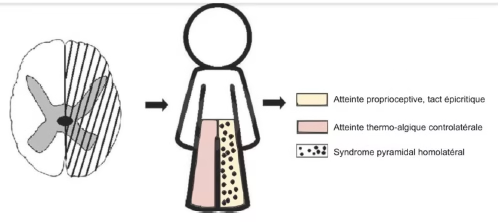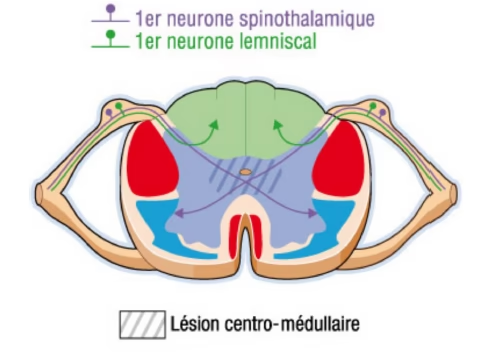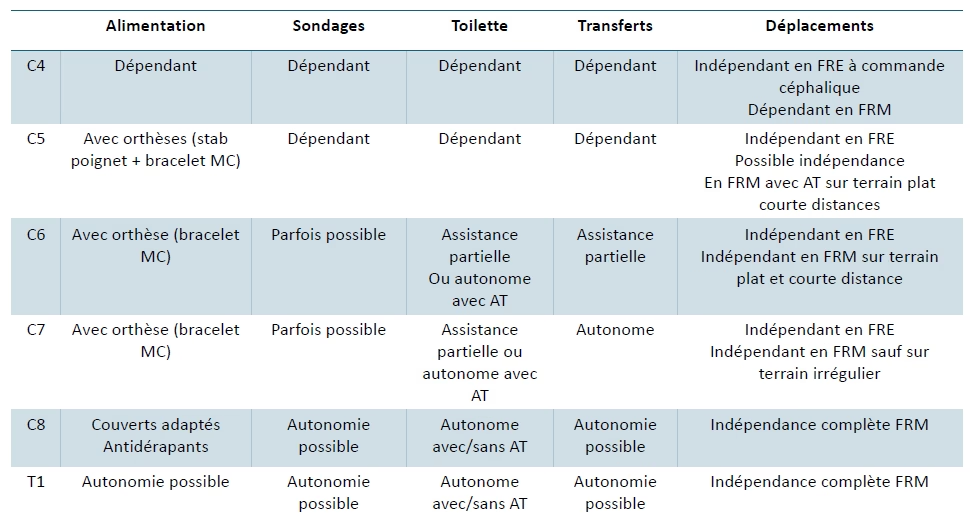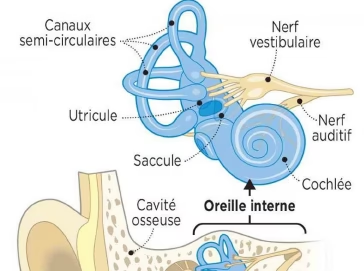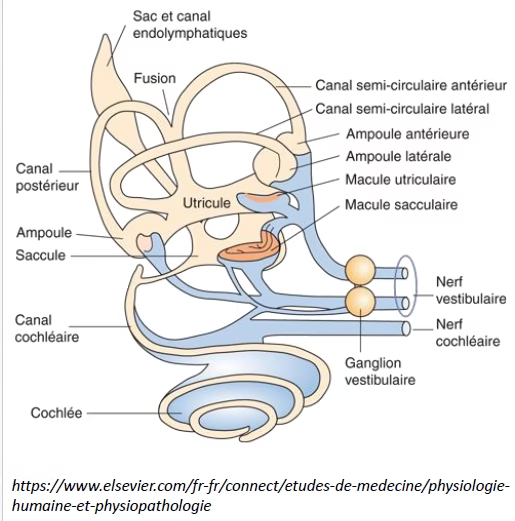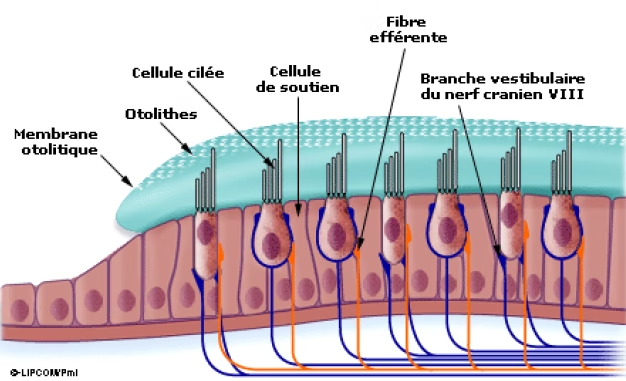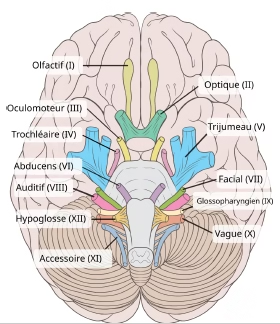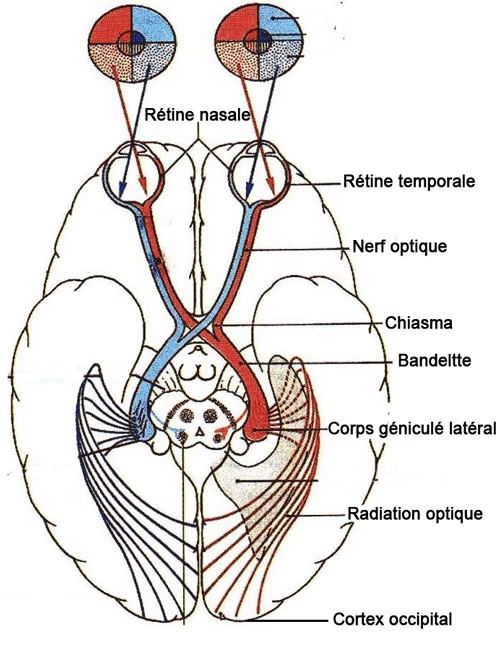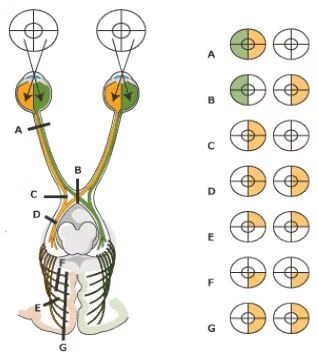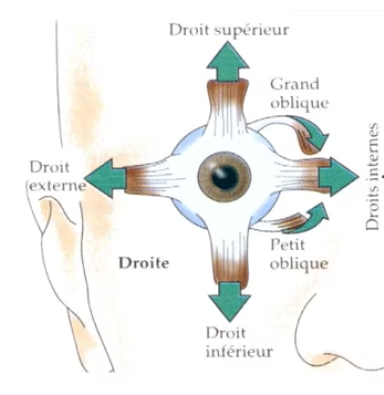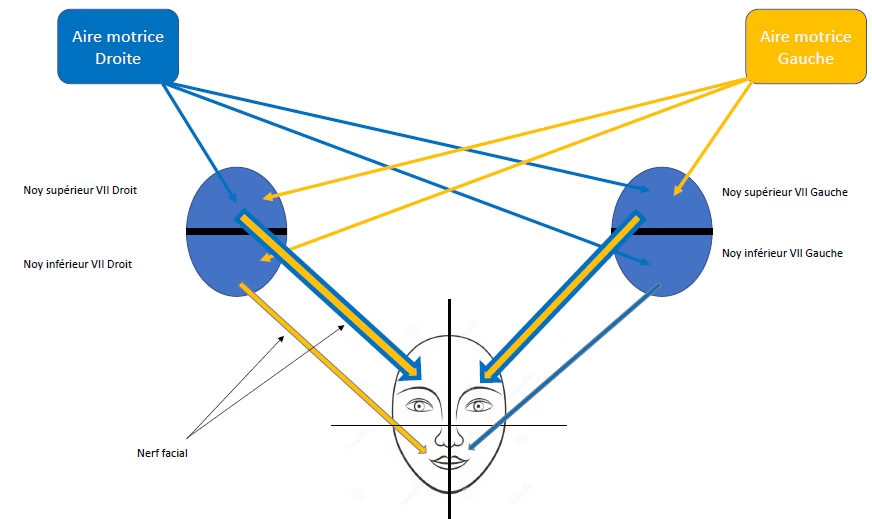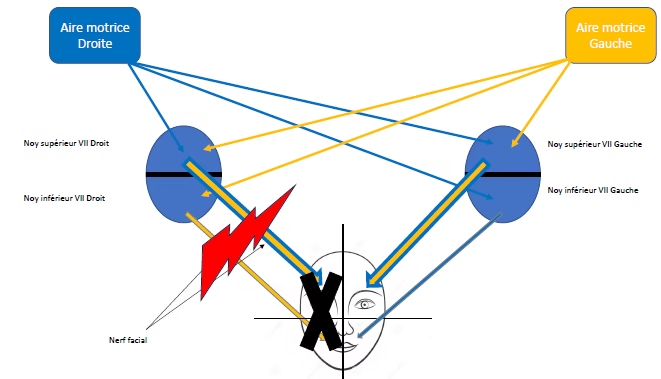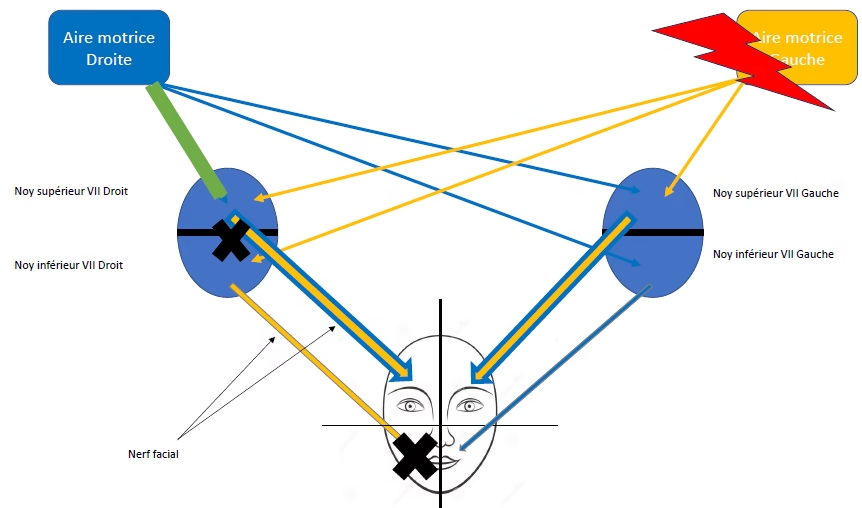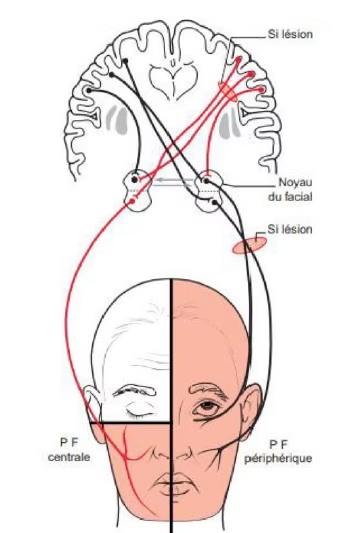Introduction
- Une pathologie fréquente et silencieuse : plus de 150 000 cas en France en 2018, grave dans 10% ds cas
- Transfert de modalité de PEC avec d’autres lésions cérébrales acquis (LCA) comme les AVC ou d’autres maladies neuro-dégénératives (MND) comme Alzheimer, SEP ou Parkinson
- Touche tous les âges : enfant (chute;accident), jeune adulte (accident), personne âgée (chute). 1ère cause de décès de l’adulte jeune
- Cause de TC : AVP (50-70%), chute (20-30%), agression, tentative de suicide (défenestration, arme à feu)
Evaluation du traumatisme crânien
Evaluation de la sévérité initiale : Glasgow Coma Scale
Sur 15 points : ouverture des yeux/4 ; réponse verbale/5 ; meilleure réponse motrice/6
| TC | GCS | Parcours |
| TC grave (10%) | entre 3 et 8 | réanimation |
| TC modérés (10-15%) | entre 9 et 12 | hospitalisation |
| TC légers (75-80%) | entre 13 et 15 | domicile |
Evaluation du devenir : Glasgow Outcome Scale
- GOS 1 : décès
- GOS 2 : état végétatif
- GOS 3 : handicap sévère. Dépendant pour les AVQ
- GOS 4 : handicap modéré. Indépendant dans les AVQ
- GOS 5 : bonne récupération. Retour à la vie normal, légère déficiences motrices ou cognitives
Classifications lésionnelles
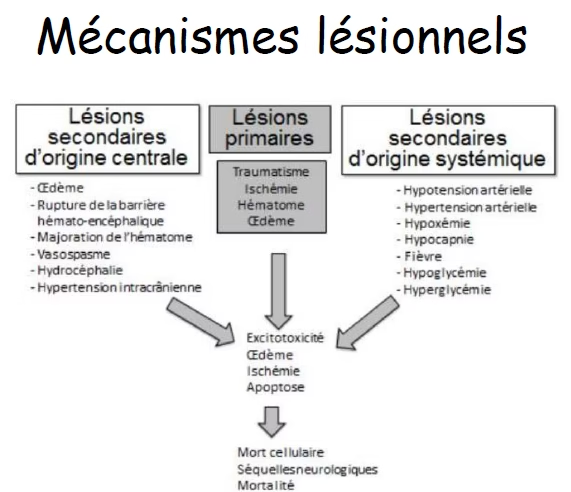
Lésions primaire
Immédiatement présentes au moment du traumatisme
1. Plaie du scalp
2. Lésion osseuse
- Fracture voûte du crâne (embarrure)
- Fracture base du crâne (massif facial)
- Risque de fuite de LCR qui peut provoquer une infection
- Risque d’atteinte des nerfs crâniens
3. Lésions intra-crânienne extra-cérébrales
- Hémorragie méningée traumatique
- Hématome extra-dural (HED) : urgence vitale absolue, lentille biconvexe hyperdense
- Hématome sous-dural (HSD) aigu : chute de la personne âgée, du consommateur d’alcool, sd du bébé secoué. Lentille hyperdense à concavité interne et externe
- Hématome sous-dural (HSD) chronique : complication tardive. Aspect hypodense
4. Lésions encéphaliques
- Focales : occasionnées par le coup et le contre-coup du traumatisme, hématome intra-cérébral hyperdense au TDM à la phase initiale
- Lésions axonales diffuses : lésions de très petites tailles de la substance blanche
Lésions secondaires
Soit par évolution des lésions primaires, soit par agressions nouvelles
1. Hypertension intra-crânienne (HTIC)
- Secondaire à un effet de masse (oedème, hématome)
- Céphalées, vomissements
- Engagement cérébral : risque vital
2. Hydrocéphalie
- Dilatation ventriculaire
- Triade de symptômes : trouble de la marche, troubles cognitifs, troubles vésico-sphinctériens
3. Traumatisme crânio-facial
- Pronostic vital, fonctionnel, esthétique
- Déficit hypothalamo-hypophysaire : trouble sexo, fatigue
Le TC grave
Prise en charge phase aigüe
- Par le SAMU : signes de détresse vitale (ventilation, hémodynamique), état de conscience (GCS), durée de la perte de conscience, bilan des lésions associées
- Vigilance : polytraumatisme, traumatisme cervicale associée
- Scanner cérébral en urgence : souvent total body scan pour le bilan des lésions associées
- Lésions chirurgicales d’emblées : HED, certains HSD, plaies cranio-cérébrale
Coma
- Définitions du coma : absence d’éveil et de manifestation de conscience
- Eveil (ou vigilance) : ouverture spontanée des yeux
- Perception consciente : capacité à interagir avec son environnement et avoir la conscience de soi
- Evaluation de la conscience : échelle CRS-R
Prise en charge : 3 objectifs
- Eviter l’aggravation des lésions cérébrales initiales
- Eviter l’aggravation secondaire des lésion
- Maintenir le patient en vie en assurant les fonctions essentielles (réanimation)
Phase de réveil du coma
- Etat pauci-relationnel : état de conscience minimal
- Evaluation : Wessex Head Injury Matrix (WHIM)
- Accueil en unité spécialisée
Amnésie post traumatique
Présentation clinique
- Confusion, agitation
- Désorientation temporo-spatiale
- Amnésie rétrograde (lacune amnésique)
- Amnésie antérograde (oubli à mesure)
La duré APT est un élément de sévérité, un critère pronostique
Evaluation sur échelle de GOAT (Galvston Orientation and Amnesia Test) : si score supérieur à 78 durant 3 jour de suite -> sortie APT
Séquelle neurologique d’un TC grave
- Atteinte neurologique : atteinte pyramidale, syndrome cérebelleux, mouvements anormaux, hypotonie axiale
- Atteinte des paires crânienne
- Troubles vésico-sphinctériens
- Troubles cognitifs et comportementaux : désorganisé, distrctible, rigide, persévérations frontales, hyperproductivité ou hypoproductivité globale
- Troubles de l’humeur : anxiété, dépression
- Autres : épilepsie, hydrocéphalie, ostéomes (POAN), SDRC, troubles endocriniens
- Troubles de la mémoire : rétrograde, antérograde, prospective (souvenir des événements à venir), mémoire de travail
- Troubles de l’attention et de la concentration
- Anosognosie
- Fatigue neurologique
- Syndrome frontal / dysexécutif : trouble de l’initiation, planification et contrôle de l’action, défaut de flexibilité, incapacité d’auto-correction
Prise en charge multi-disciplinaire
- Kinésithérapie : rééducation neurologique des déficiences
- Ergothérapeuthe, neuro-psychologue, orthophoniste
Le TC léger
Définition
- Perte de connaissance initial inférieure à 30mn
- GCS entre 13 et 15
- APT < 24h
- Altération mentale au moment de l’accident : confusion, désorientation
- Anomalie neurologique transitoire
Evolution du TC léger
A 2 semaines
- Symptômes post trama : céphalée, vertige, asthénie
- Troubles émotionnels : anxiété, dépression, stress post traumatique
A 6 mois
- 44% de guérison incomplète
- Stress post-traumatique : 45%
- Retour au travail/étude : 1/3 n’ont pas repris
- Facteurs défavorables pour le retour au travail : lésions associées extra-crâniennes, douleurs, niveau d’éducation <11 ans d’études
Syndrome post-commotionnel
- Troubles somatiques : céphalée, vertige, troubles du sommeil, fatigue, troubles sensoriels (éblouissement à la lumière, intolérance au bruit)
- Troubles cognitifs : troubles de l’attention et de la mémoire de travail
- Troubles émotionnels : irritabilité, anxiété, dépression
Fréquents à la phase initiale
Persistance des troubles >3mois = syndrome post-commotionnel persistant
Syndrome post-commotionnel persistant
- Synptômes très variés : organique, psychologique et neuro-fonctionnel
- Red flag : ATCD de TC, psychiatriques, tiers responsable de l’accident, isolement, situation personnelle complexe
Conduite à tenir
- Activité physique : reconditionnement à l’effort
- PEC psychothérapeutique
- PEC courte, sans trop médicaliser
Complication du coma et de la réanimation
- Cardio-vasculaires, respiratoires : TVP, AVC, encombrement, désadaptation à l’effort, pneumopathies acquise sous ventilation mécanique (PAVM)
- Cutanées : escarres
- Nerveuses : lésions tronculaires, compression, lésions plexiques (plexus brachial), spasticité (si lésion pyramidale)
- Musculaire : neuromyopathie de réanimation (atteinte nert et/ou muscle), rétraction
- Articulaire : capsulite d’épaule, SDRC, perte d’amplitude articulaire
- Cognitive, psychiatrique et psychologique : syndrome post-traumatique, anxiété
- Trouble de la déglutition