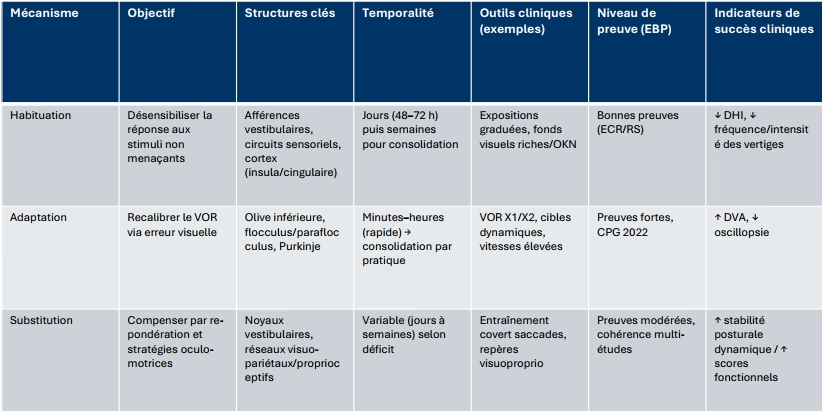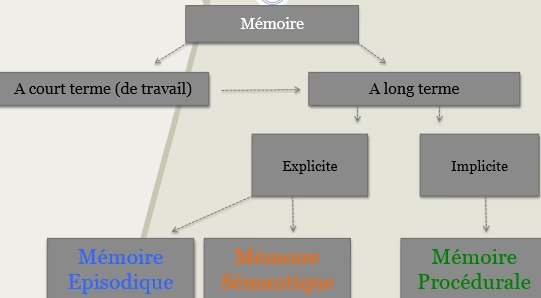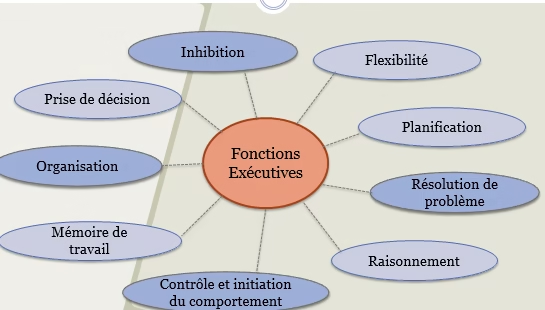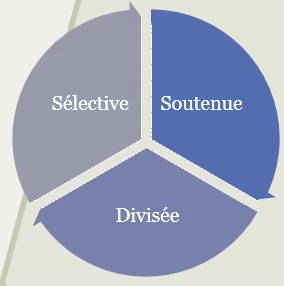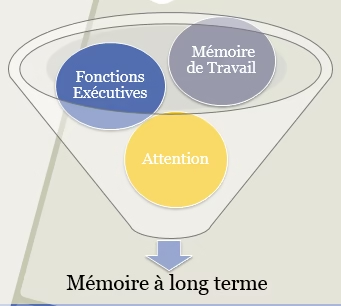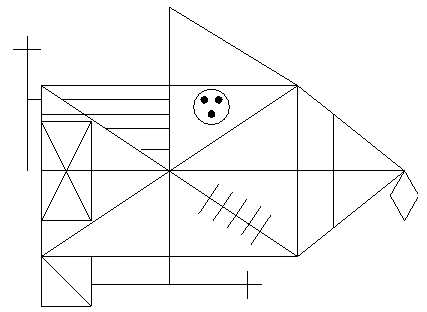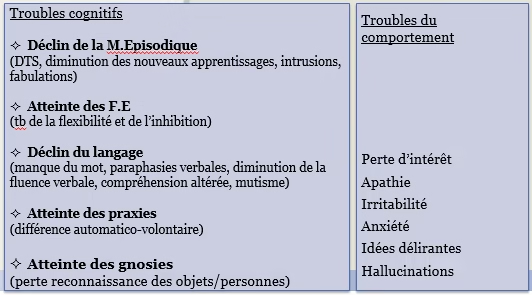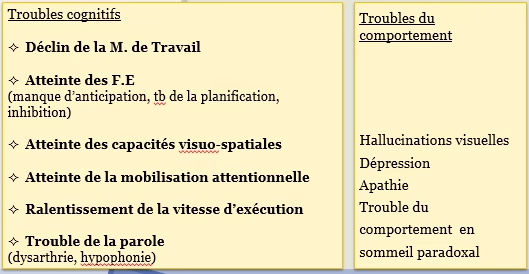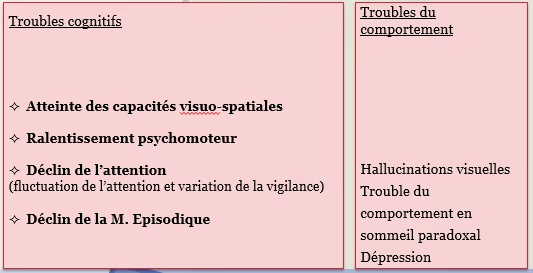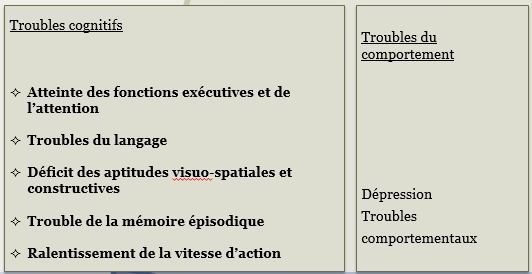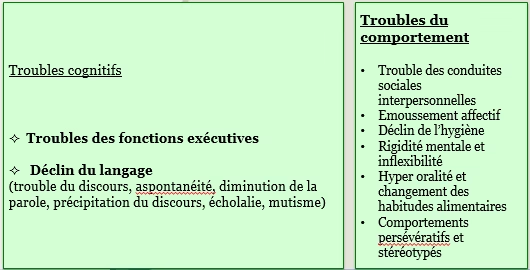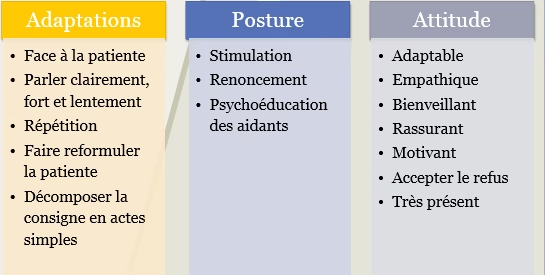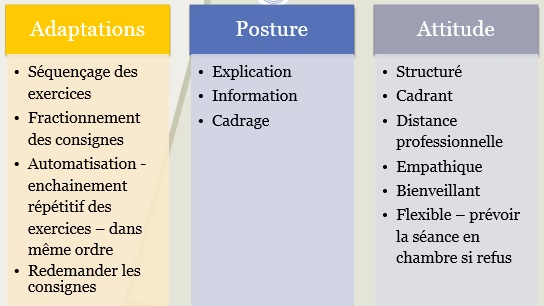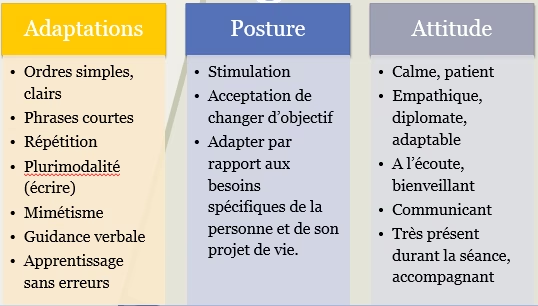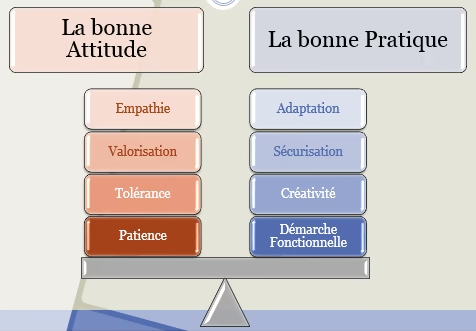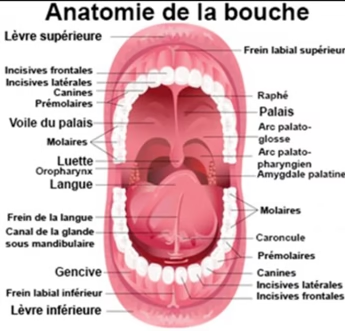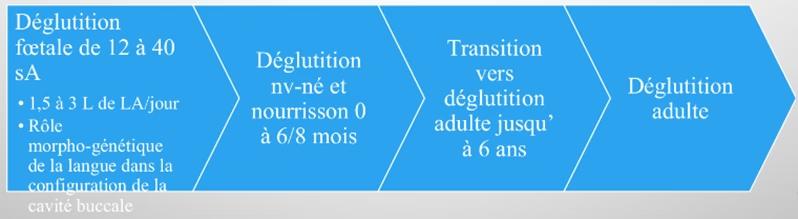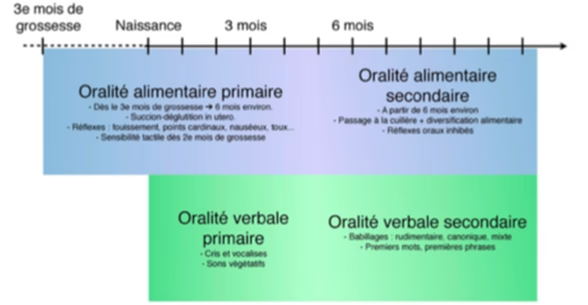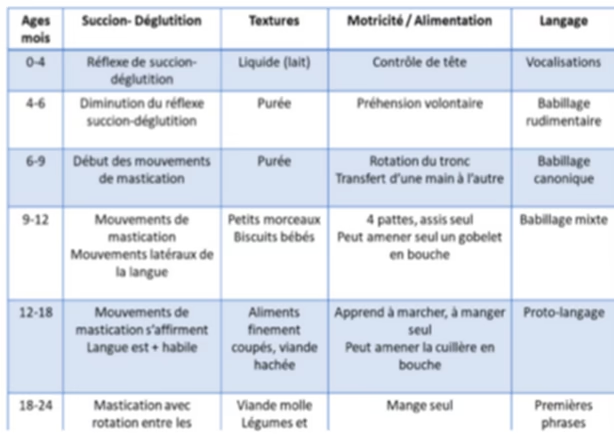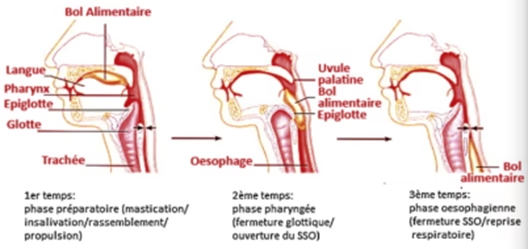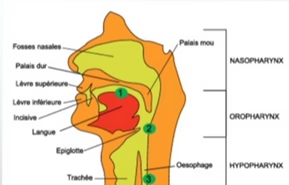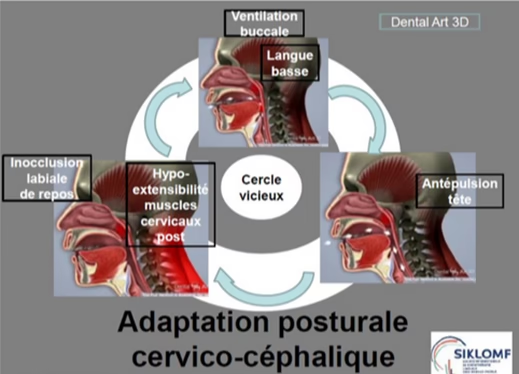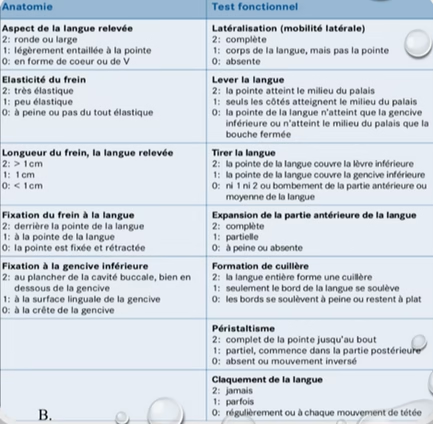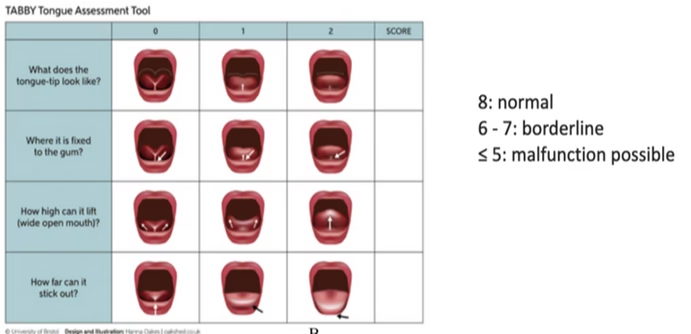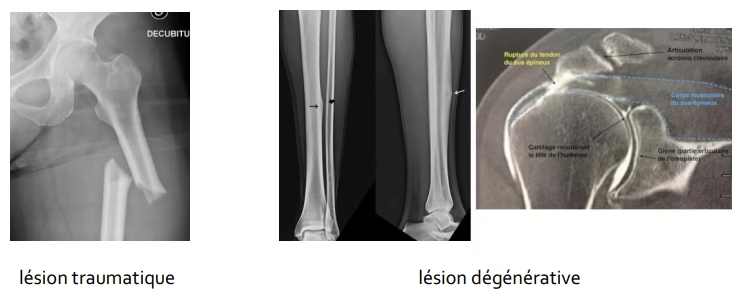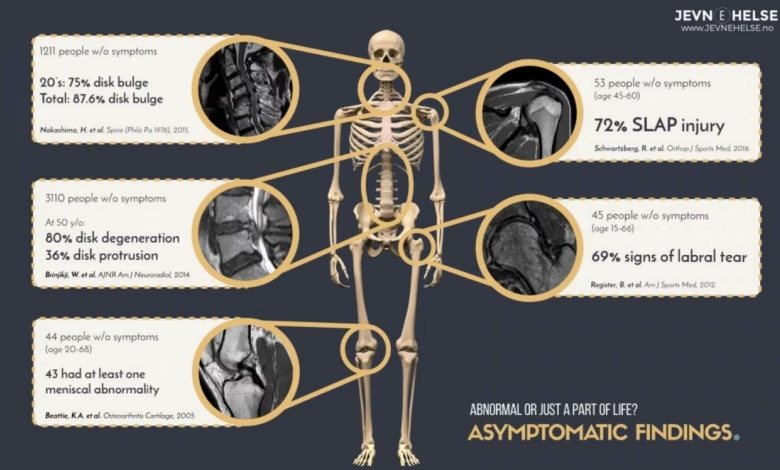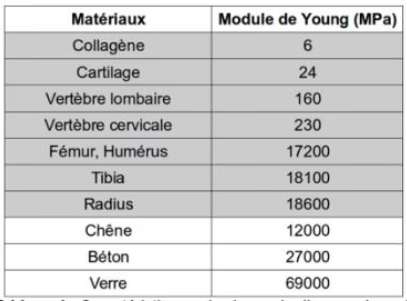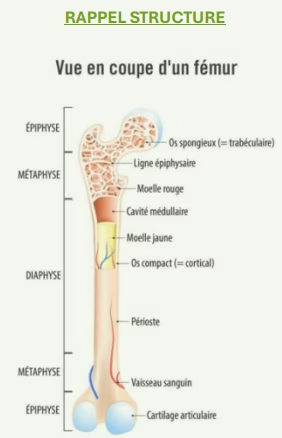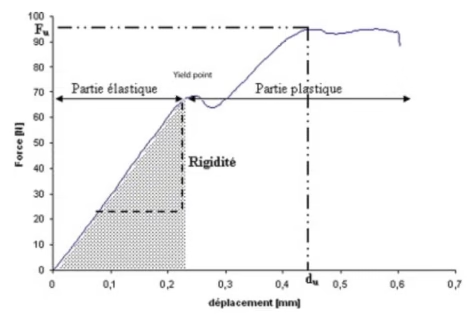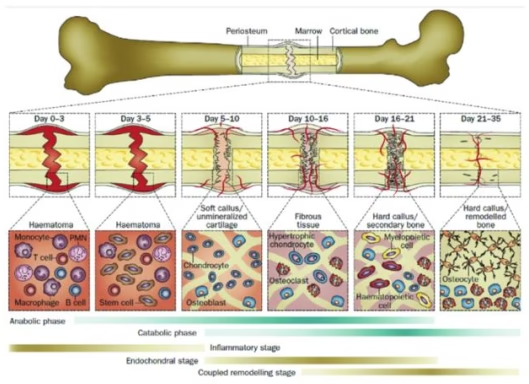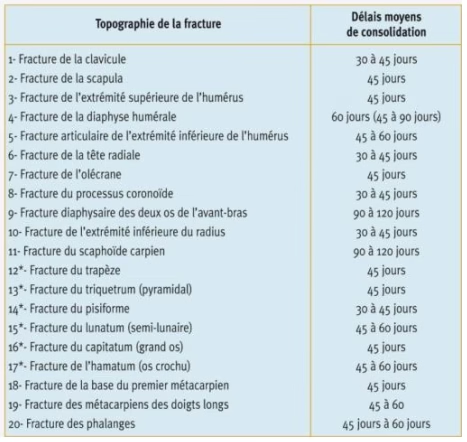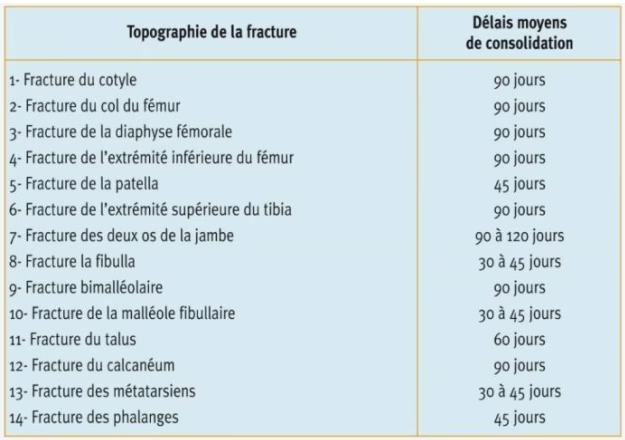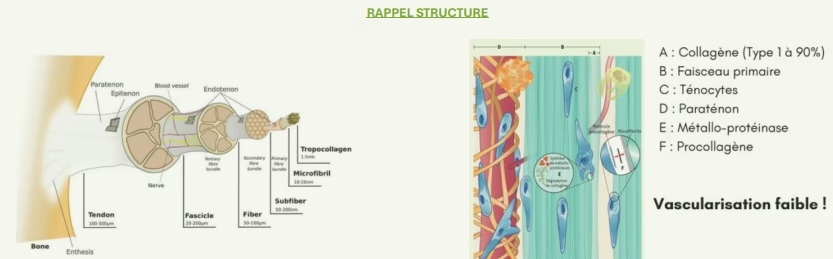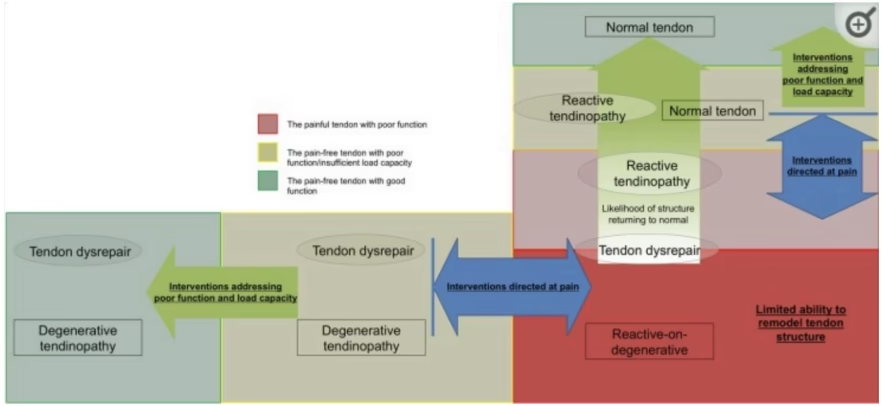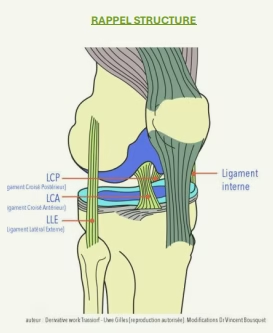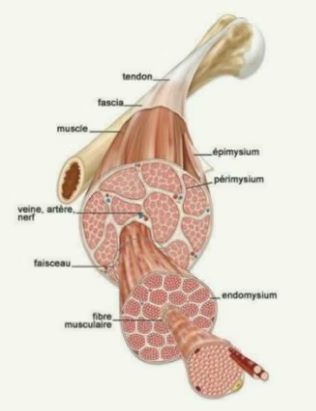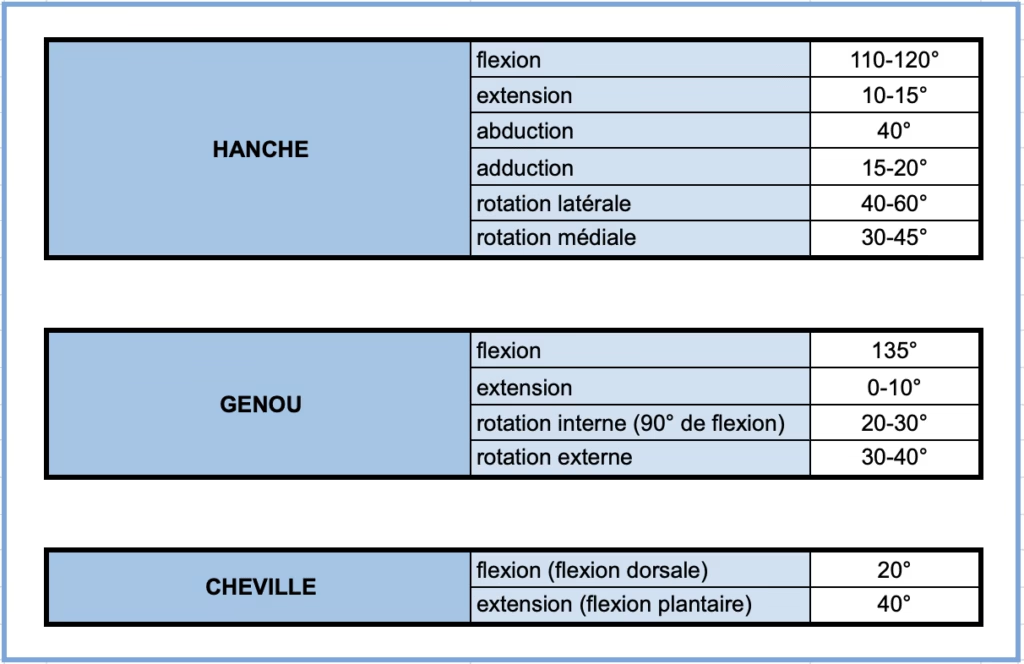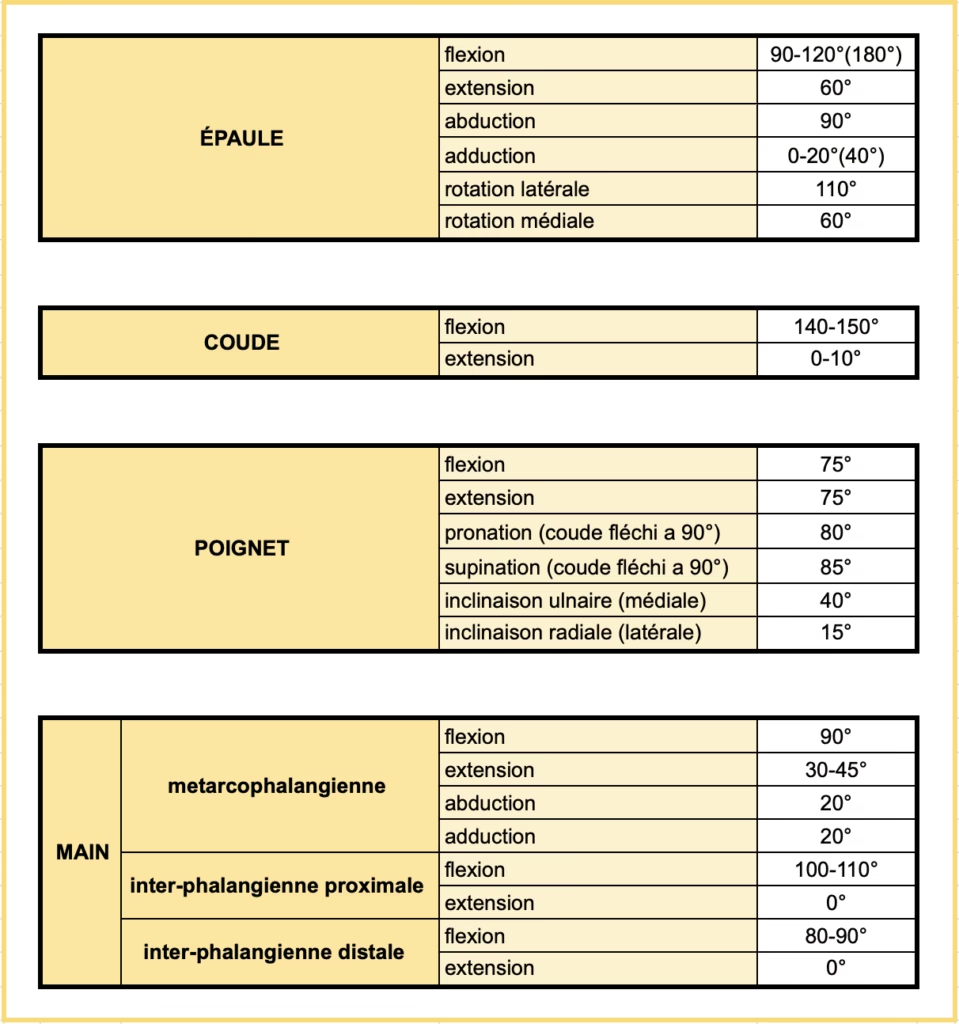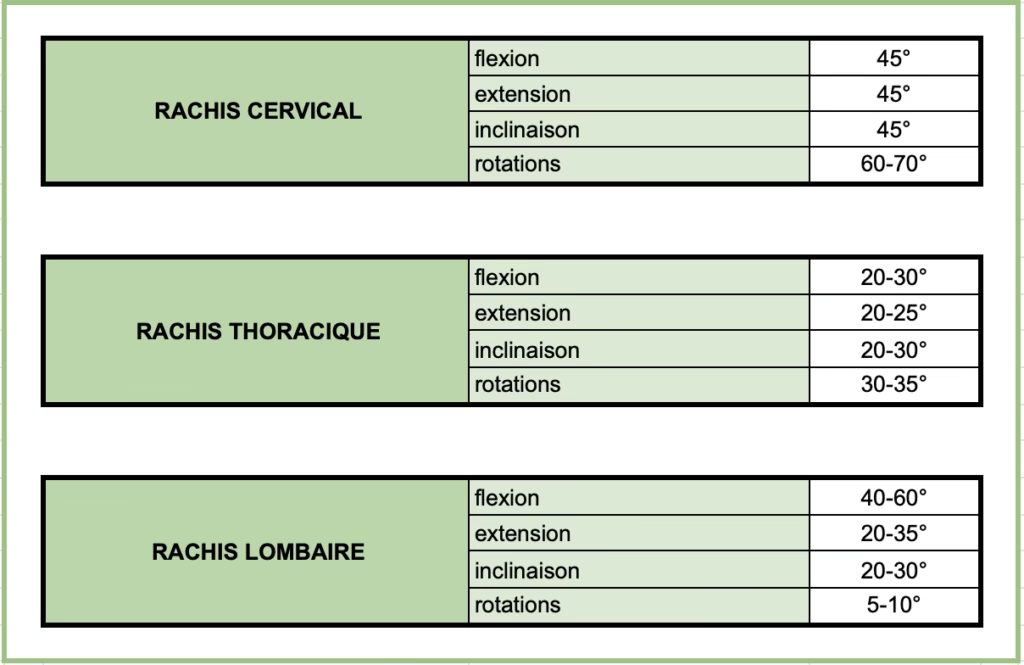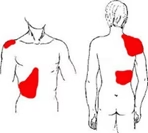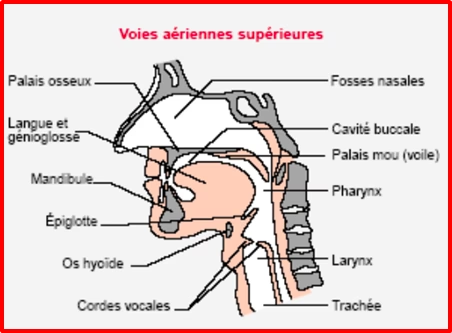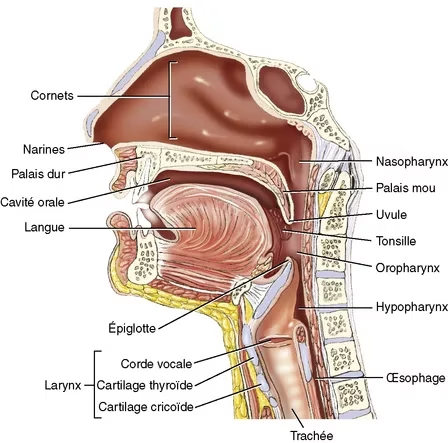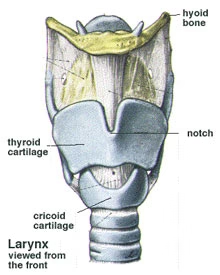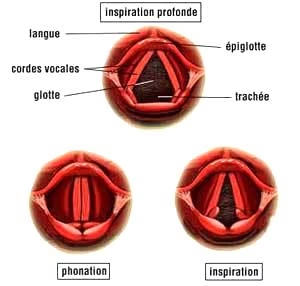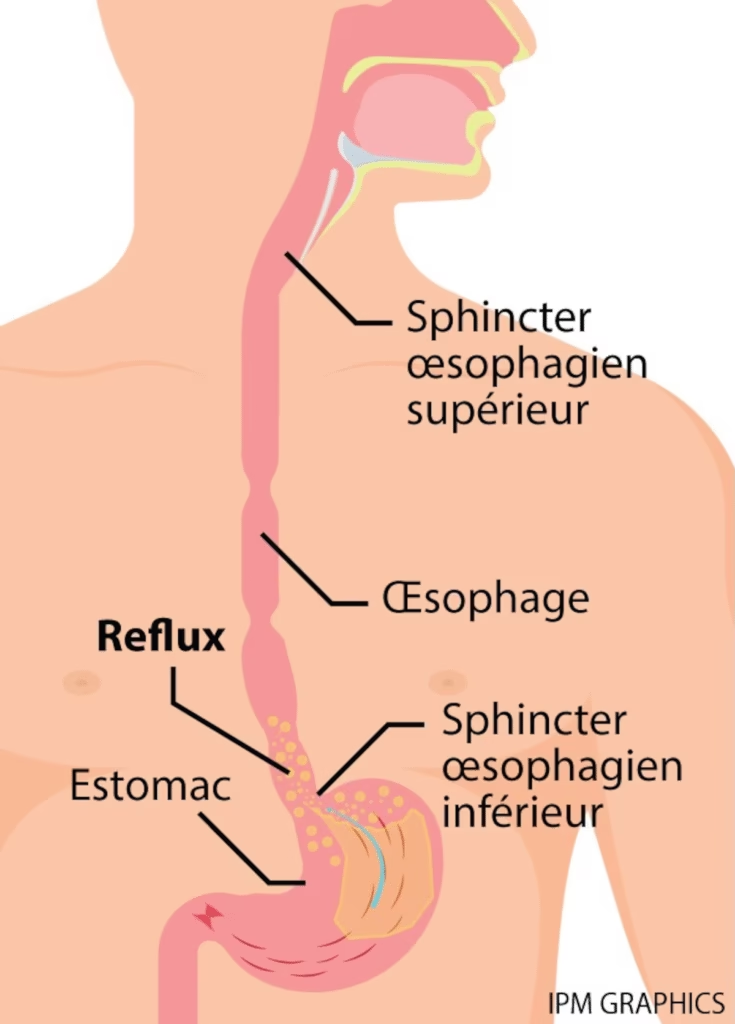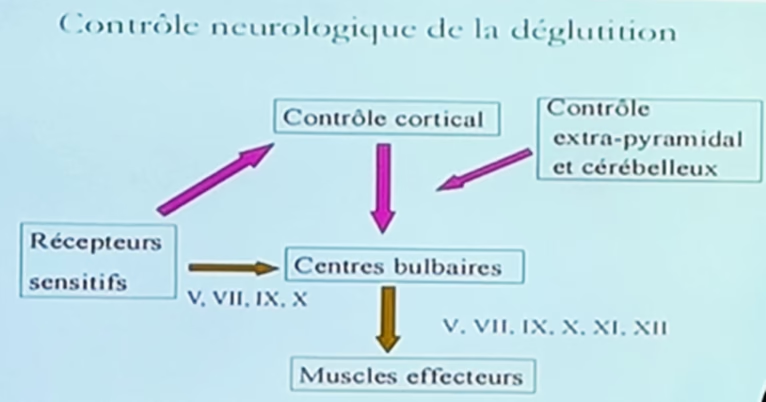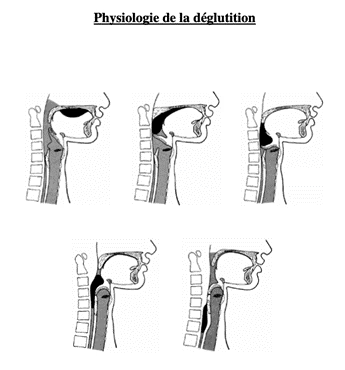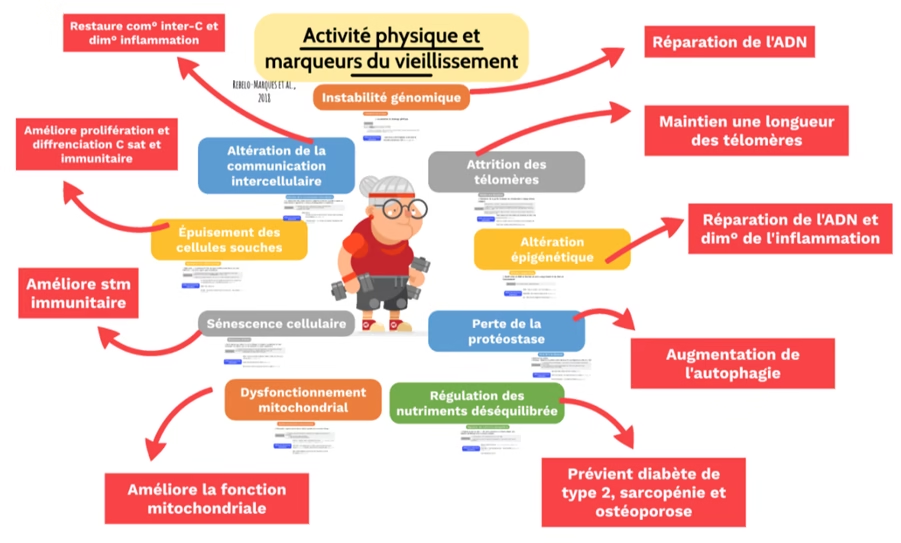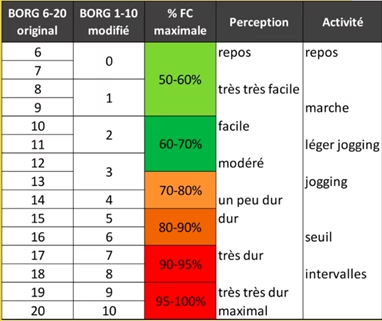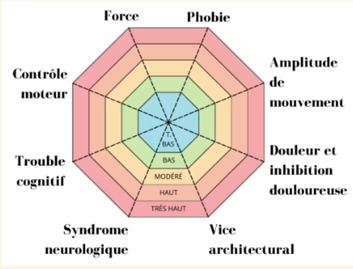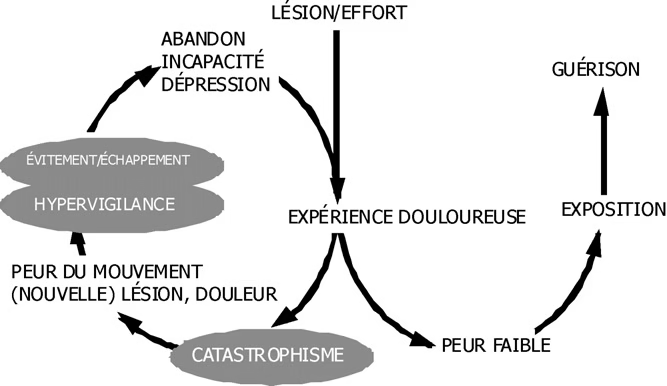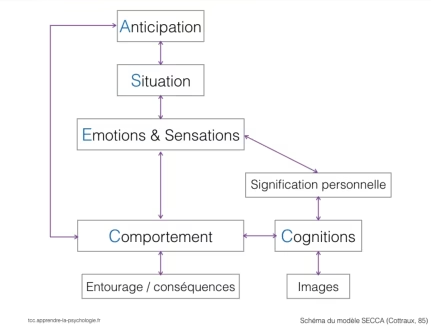Introduction
Objectifs
- Différencier les principales pathologies vestibulaires
- Maîtriser l’examen clinique et les tests diagnostiques
- Choisir le traitement adapté à chaque pathologie
Concepts clés
- La rééducation repose sur :
- la compensation centrale
- la plasticité neuronale
- Le diagnostic différentiel guide la prise en charge
Anatomie vestibulaire
Système périphérique
- 3 canaux semi-circulaires : détection des rotations
- Utricule & saccule : gravité et accélérations linéaires
- Nerf vestibulaire : transmission de l’information
Système central
- Noyaux vestibulaires : intégration multisensorielle et génération des réflexes vestibulo-oculaire (RVO) et vestibulo-spinal(RVS)
- Cervelet : calibre et adaptation
- Cortex : perception et intégration
A retenir
Le vestibule détecte, les noyaux vestibulaires génèrent les réflexes, le cervelet les calibre et les adapte, et le cortex les intègre, les régule et en fait une perception consciente
VPPB
Signes clinique
- Aigu : vertige bref (en général <1 minute) déclenché par les changements de position
- Chronique : instabilité persistante à la marche / position statique
Diagnostic clinique
- Manœuvre de Dix-Hallpike → canal postérieur (nystagmus torsionnel + vertical sup
- Roll Test → canal latéral (nystagmus horizontal géotropique ou agéotropique)
- Caractéristique : latence courte + épuisabilité à la répétition
Traitement
- Manœuvres de repositionnement (Epley, Sémont, Lempert)
- Rééducation vestibulaire si instabilité résiduelle
Consignes post manoeuvre VPPB
Reprendre les activités normales immédiatement.
- Bouger la tête normalement, sans restriction.
- Dormir dans la position habituelle.
- Informer : vertiges/nausées légers possibles 24–48h (20–30%).
- Contrôle dans 3–5 jours pour vérifier efficacité ou récidive.
En synthèse
- Ce qu’il faut dire : « Vous pouvez bouger et dormir normalement. »
- Ce qu’il faut éviter : consignes restrictives inutiles (ne pas bouger, dormir assis, etc.).
- Contrôle systématique dans 3–5 jours pour suivi clinique.
Déficit vestibulaire unilatéral aigu (DVUA ou névrite)
Présentation clinique
Grand vertige rotatoire continu (24–72 h) avec :
- Nystagmus spontané horizontal (vers le côté sain)
- Instabilité posturale sévère (chute du côté atteint)
- Nausées / vomissements importants
- Sans perte auditive → oriente vers atteinte purement vestibulaire
Evolution en 2 phases
Aiguë
- Nystagmus horizontal battant vers le côté sain
- HIT / vHIT positif du côté atteint (déficit du réflexe vestibulo-oculaire)
- Instabilité majeure (station debout difficile voire impossible)
- Vertiges intenses durant 1 à 3 jours
Phase chronique (compensation centrale)
- Instabilité résiduelle aux mouvements rapides de tête
- Étourdissements
- Déficit calorique unilatéral
Prise en charge
Phase aiguë : vestibulo-suppresseurs → courte durée (≤ 72 h)→ Objectif : soulager les symptômes sans bloquer la compensation centrale
- Phase de récupération : rééducation vestibulaire +++
Rééducation précoce
- Plus la rééducation est débutée tôt, plus la récupération est rapide et complète, moins le risque de vertiges chroniques résiduels
Maladie de Ménière
Triade symptomatique
- 1. Vertiges rotatoires (20 min à plusieurs heures)
- 2. Hypoacousie fluctuante prédominant sur les fréquences graves
- 3. Acouphènes + plénitude d’oreille
Evolution
- Crises récidivantes → perte auditive neurosensorielle progressive
- Atteinte bilatérale : 20–40 % des cas (évolution à long terme)
- Instabilité intercritique croissante avec la durée de la maladie
Traitement et rôle du kiné
- Crise : vestibulo-suppresseurs + antiémétiques (≤ 72 h), repos relatif
- Cas invalidants : gentamicine intratympanique ± corticoïdes, chirurgie en dernier recours
- Kiné : éducation thérapeutique, rééducation vestibulaire, gestion de l’instabilité post-crise
Désorganisation sensorielle
Caractéristiques
Vertiges non rotatoires, déséquilibre et désorientation spatiale sans atteinte vestibulaire périphérique
Déclenchés par :
- Mouvements passifs (voiture, bateau, avion)
- Environnements visuels dynamiques (foule, supermarché, écrans)
Evaluation
- Bilan vestibulaire négatif (pas de déficit périphérique)
- Questionnaires validés
- DHI (Dizziness Handicap Inventory)
- Motion Sensitivity Quotient (MSQ)
- Niigata PPPD Questionnaire (si suspicion de PPPD)
- Tests fonctionnels :
- CTSIB / mCTSIB → évalue la dépendance sensorielle
- Posturographie dynamique → résolution des conflits sensoriels
Rééducation
- Habituation : exposition graduée et répétée aux stimuli visuels ou posturaux déclencheurs
- Conflits visuo-vestibulaires : entraînement optocinétique, réalité virtuelle immersive validée
- Intégration sensorielle : réapprentissage du sensor reweighting pour résoudre les conflits multisensoriels
3 types d’exercices en rééducation vestibulaire
Habituation
- Définition : Réduire progressivement les symptômes par exposition contrôlée et répétée aux stimuli déclencheurs.
- Mécanisme : Désensibilisation centrale → réduction de la réactivité neuronale et de l’activité des centres émétiques/anxiogènes.
- Principe : « S’exposer pour s’habituer » – extinction progressive de la réponse aversive.
Adaptation
- Définition : Améliorer la performance du système vestibulaire résiduel par des exercices sollicitant les interactions sensorielles.
- Mécanisme : Plasticité cérébelleuse → modification du gain du réflexe vestibulo-oculaire (VOR).
- Principe : « Faire mieux avec moins» – optimisation du vestibuledéficitaire
Substitution
- Définition : Développer des stratégies compensatoires via la vision et la proprioception.
- Mécanisme : Repondération sensorielle centrale → augmentation du poids des signaux visuels et proprioceptifs.
- Principe : « Compenser par d’autres voies » – suppléer la fonction vestibulaire.
- Formes :
- Sensorielle → vision/proprioception
- Comportementale → ajustements moteurs
Quand arrêter la rééducation vestibulaire ?
Critères d’arrêt positifs
- Objectifs fonctionnels atteints →retour aux activités sans limitation.
- Réduction cliniquement significative des vertiges / instabilité.
- Scores normalisés : DHI ≤ 30, ABC ≥80Tests d’équilibre et VOR compensés.
- Amélioration ≥ 18 pts au DHI =significative
Critères d’arrêt négatifs
- Plateau thérapeutique ≥ 3–4semaines malgré progression adaptée.
- Aggravation persistante malgré ajustements du programme.
- Comorbidités intercurrentes limitant la participation.
- Non-adhésion : exercices <3×/semaine.
- Avant arrêt → réévaluer diagnostic, programme et observance.
Approche centrée patient & EBP
- Décision partagée → le patient peut interrompre à tout moment.
- Explorer les motifs : attentes,contraintes, amélioration,motivation.
- Proposer suivi à distance ou exercices autonomes.
- Réévaluation toutes les 2–3semaines pour maintenir la motivation.
- Outils : DHI, ABC, FGA, mCTSIB
Points clés à retenir
Démarche diagnostique
- 1. Anamnèse précise : durée, déclencheurs, symptômes associés
- 2. Recherche de perte auditive → oriente (Ménière / non Ménière)
- 3. Tests adaptés : Dix-Hallpike, Roll test, HIT/VHIT
- 4. Traitement aligné sur le diagnostic
- Red Flags → orientation médicale immédiate (céphalées, diplopie, déficit neurologique, chute sansvertige, HINST)
Règles d’or
- VPPB : bref + positionnel → manœuvre de repositionnement + rééducation si instabilité résiduelle
- DVUA (névrite) : constant + sans surdité → rééducation précoce (idéalement < 3 jours)
- Ménière : crises + surdité + acouphènes → éducation + rééducation
- Plus la prise en charge est précoce, meilleure est la récupération.
HINTS : pour écarter une cause centrale du vertige
HINTS : Head Impulse – Nystagmus – Test of skew
Objectif : identifier si un syndrome vestibulaire aigu (SVA) relève d’une atteinte centrale (AVC postérieur) ou périphérique ( DVUA).
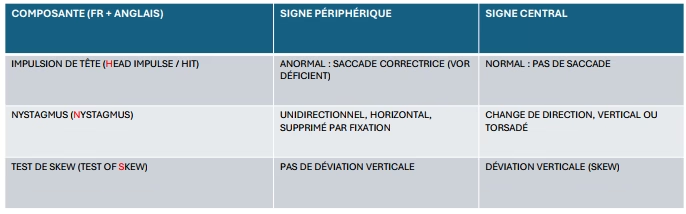
Interprétation rapide du HINTS
- Signes périphériques (HIT+, Nystagmus unidirectionnel, Skew-) : origine périphérique probable
- Plus d’un signe central -> Suspicion AVC post -> Imagerie urgente (IRM)
Troubles vestibulaires
Troubles vestibulaires périphériques(TVP)
- Pathologies de l’oreille interne ou du nerf vestibulaire
- ↓ signaux sensoriels tête (position/mouvement)
- →atteinte de détection
Objectifs : Restaurer VOR, adaptation + substitution
Troubles vestibulaires centraux (TVC)
- Atteinte noyaux vestibulaires, cervelet, tronc cérébral ou cortex
Perturbation intégration multisensorielle (vestibule/vision/somesthésie)
Objectifs : compensation centrale, adaptation + substitution + habituation
3 types d’éxercices en rééducation vestibulaire (bonus)
Mécanismes de plasticité
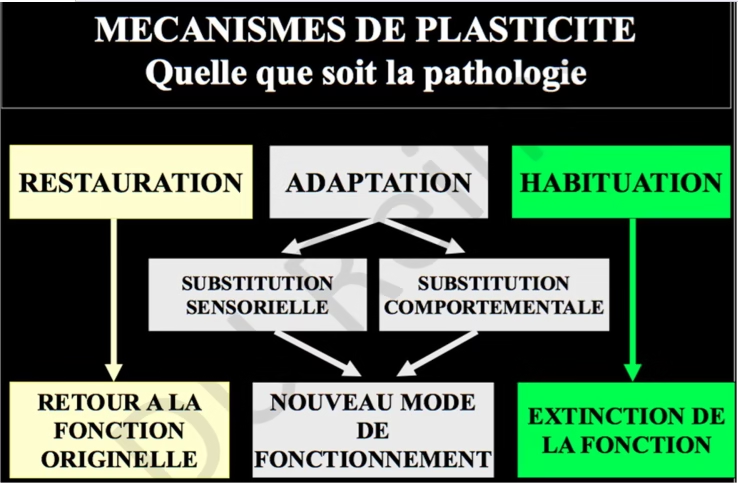
Synthèse des 3 mécanismes
Habituation : Plasticité synaptique et désensibilisation centrale
Principe : Exposition graduée + Répétition espacée = Consolidation durable
Adaptation : Plasticité cérébelleuse et recalibrage du VOR
Principe : Générer une erreur rétinienne → Recalibrage cérébelleux → Amélioration du gain VOR
Substitution : Re-pondération sensorielle et stratégiescompensatoires
Principe : Optimiser les entrées sensorielles alternatives + stratégies oculomotrices compensatoires