Introduction
Définition
Cicatrisation
Processus biologiques qui surviennent à la suite d’une plaie et permettent la réunion des parties divisées
Parties molles
- Peau et tissu sous cutané + éléments qui y passent : tendons, nerfs, vaisseaux, muscles
- Excluent les os, les articulations et les organes
Cicatrisation cutanée
Composition de la peau
- Epiderme : tissu épithéliale (couche la plus superficielle) permet un recouvrement étanche
- Derme : tissus conjonctif assurant l’élasticité et la solidité de la peau
2 phénomènes cicatriciels
- La cicatrice conjonctive
- Le recouvrement
Rôle de la peau
- Protection contre les traumatismes mécaniques (chocs)
- Régulation thermique (vasomotricité, sudation)
- Barrière contre les pertes hydro-électrolytoques
- Barrière contre les invasions bactériennes
- Sensibilité tactile, nociceptive, thermique
- Esthétique
Constitution de la peau
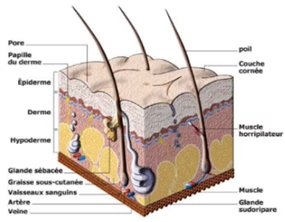
Epiderme (épithélium)
- Constitué de cellules kératinocytes posées sur la membrane basale
- Ce sont des cellules basales qui meurent et qui remontent à la surface
- “Turn over” (tapis roulant) qui renouvelle l’épiderme
- Toutes les kératinocytes sont renouvelées toutes les 2-3 semaines
Derme (tissu conjonctif)
- Constitué de fibroblastes qui fabriquent les fibres collagènes (solidité) et d’élastine (élasticité)
- Annexe épidermique (follicules pileux, glandes sudoripares et sébacées) capable de synthétiser des poils mais également de l’épiderme en cas de cicatrisation
Hypoderme
Couche graisseuse
Causes de blessure
- Plaie traumatique franche : couteau
- Plaie contuse : objet non tranchant
- Arrachement
- Ecrasement avec nécrose cutanée
- Plaie chirurgicale : incision ou excision
- Brûlure, escarre
Cicatrisation
Physiologie globale
- Phénomène biochimique -> mécanismes histologiques -> évolution clinique
- Blessure épiderme/derme -> nécrose cellulaire avec effraction vasculaire -> formation caillot de sang (permet l’arrêt de l’hémorragie) -> début de cicatrisation
Les 3 étapes de la cicatrisation
Détersion : évacuation de la nécrose et du caillot (nettoyage de la plaie)
- Granulation (bourgeonnement) : cellules comblent la plaie par un bourgeonnement charnu (cicatrisation conjonctive)
- Epithélialisation (épidermisation) : recouvre le tissu de granulation
Les phases du bourgeonnement
Prolifération de fibroblastes
- Migre dès 48 heures à partir des berges puis multiplication
- Synthétise la substance fondamentale de la matrice intercellulaire (glycosaminoglycanes)
- Synthèse du collagène de type III (embryonnaire ou “immature”) puis type I et d’élastine
Les myofibroblastes
- Proviennent des fibroblastes et contiennent des cellules contractiles
- Les plaies se rétractent par l’action des myofibroblastes
Bourgeon charnu
- Tissu de granulation de couleur rouge
- Attention à l’hyper bourgeonnement (quand le tissu va plus haut que la peau)
Phase d’épidermisation
- Quand la plaie est comblée
- Migration des kératinocytes qui sont autour de la cicatrice
- Les mélanocytes (pigments de la peau) et les cellules de Langerhans (cellules immunologiques) colonisent ensuite l’épiderme
Aspect bactériologique
- La plaies n’est jamais stérile, il y a toujours des bactéries
- Elles jouent un rôle de détersion suppurées de la plaie : elles mangent le pu de la nrécose
- Si infection virulente : blocage de la cicatrisation et possible infection locorégionale ou générale (septicémie)
Types de cicatrisation
Cicatrisation de seconde intention
- Correspond aux 3 phases : détersion – bourgeonnement – épidermisation
- Les 2 berges sont à distance : perte de substance
- Evolution avec pansement simple
Cicatrisation de première intention
- Traitement chirurgical pour fermer directement la plaie
- Conditions nécessaires
- absence d’infection
- absence de nécrose
- parage chirurgical parfait
- Suture bord à bord : 2 berges en contact
- Risque de rétraction
- évolution centripète au niveau de la plaie
- Diminue la taille de la plaie : bénéfique ou délétère ?
- Bord rosé autour de la plaie : début de migration kératinocytose
Remodelage de la cicatrice
- Dernière étape: maturation cicatricielle
- Dure plusieurs mois voire jusqu’à 2 ans
- Derme se transforme en tissu ressemblant à un derme normal (pas de retour à l’état antérieur)
Type de cicatrice
Cicatrice normal
- Premiers mois : phase hypertrophique (inflammatoire, rouge, chaleur, démangeaison)
- Quelques mois après : inflammation diminue, dégonflement
- 1 an : mature
Cicatrice hypertrophique
- Hyperplasie persistante au-delà de 12 mois
- Guérit en 18 mois à 2 an
- Aspect rouge, gonflée (anomalie)
Cicatrisation chéloïde
- Cicatrice indéfiniment immature, siège d’une inflammation chronique
- Facteurs favorisants
- Localisation : région deltoïdienne, pré-sternale, scapulaire, ppubienne, oreille (surtout lobule)
- Âge : <30 ans (les vieux ont des cicatrices moins visibles)
- Ethnie : surtout personnes noires et asiatique
Cicatrisation nerveuse
- Dégénérescence de l’axone puis repousse de 1 à 8mm par jour
- Tous les axones ne retrouvent pas le même chemin parfois
- Complication : formation de névrome
- Le courant nerveux ne repasse pas après suture
Vaisseaux
- Section totale : rétraction avec arrêt de l’hémorragie
- Section partielle : persistance d’une hémorragie
- La circulation peut repartir après suture
- Complications
- Faux anévrisme : la plaie sur l’artère devient un espace inclus à ‘l’artère (pas issu d’une dilatation)
- Fistule artério-veineuse : le sang de l’artère va directement à la veine sans avoir irrigué les organes
- Thrombose
Muscles et tendons
- Cicatrisation : remplacement des fibres lésées par un tissu fibreux non fonctionnel (non contractile)
- Le tendon est déjà un tissu fibreux. Il peut présenter des problèmes d’adhérence : le tendon ne coulisse plus
Les escarres
Physiopathologie
- Nécroses ischémiques par compression pouvant atteindre la peau, le tissu cellulaire sous cutané et les muscles
- Compression entre un plan dur et une saillie osseuse entraînant une nécrose tissulaire si prolongée
- L’escarre prend le nom de la saillie osseuse : trochantérienne, ischiatique, sacrée, calcanéenne, etc
Les facteurs de risque
Trouble de la sensibilité/motricité avec :
- Facteurs psychologiques (démission du patient, dépression)
- Insuffisance de PEC
- Malnutrition avec atrophie musculaire
- Infection urinaire/pulmonaire (maladies intercurrentes infectieuses)
L’escarre peut décompenser cet état très précaire
Traitement : traiter les FDR
Les stades de l’escarre
- 1. Erythème : rougeur
- 2. Désépidermisation
- 3. Ulcération
- 4. Nécrose (sèche ou humide)
Prévention des escarres
Paraplégique
- PEC par le patient lui-même impérative
- Eviter points d’appui prolongé
- Eviter perte de poids et déshydratation
- Regarder dans le miroir si des escarres se constituent
Patients dépendants
- Grabataires ou comateux
- Surveillance des zones d’appui
- Changement de position toutes les 2h
- Matelas de prévention anti-escarre statique ou dynamique, lit fluidisé
Traitement médical des escarres
Traiter tous les facteurs déclenchants ou aggravants
- Dénutrition
- Infection (locale, urinaire, pulmonaire, septicémie)
- Soutien psychologique
- Mobilisation et PEC kiné
- Traitement d’une éventuelle tare associée qui se décompense (cause et conséquence)
Traitement chirurgical de l’escarre
Cicatrisation de première intention
- Absence d’infection, enlever nécrose, suture
- Recouvrement par un lambeau
Escarre calcanéenne
Pas de solution chirurgicale satisfaisante
Escarres sacrées
- Chirurgie si escarre unique (les autres ont déjà cicatrisées)
- Si escarre importante et d’évolution très lente malgré un traitement médical bien consuit
- Patient volontaire
- Réalisation : peau et muscle fessier pour combler -> incision en V et cicatrisation en Y ou lambeau en rotation
Escarres ischiatiques et trochantériennes
- Nécessite toujours une intervention chirurgicale (ne cicatrise quasiment jamais)
- Ces é localisations communiquent avec une bourse séreuse de glissement au contact de l’os qui, une fois ouverte, empêche toute cicatrisation spontanée
- Réalisation : lambeau de l’IJ (V-Y) ou du grand fessier pour combler le trou
Escarres trochantériennes
- Ne cicatrise pas seul
- Lambeau musculo-cutané de fascia-lata
Escarre de fin de vie
- Chirurgie de propreté avec parfois amputation
- Objectif : fin de vie décente
Techniques de chirurgie
Cicatrisation centripète (avec expansion)
- greffe de peau sur une maille
- Les kératinocytes migrent vers l’intérieur pour refermer la maille
Cicatrisation centrifuge (technique de Meek)
- cicatrisation à partir de petits carrés de peau prélevés sur le patient
- Les kératinocytes migrent vers l’extérieur, démultipliant ainsi la surface de greffe
Substitut dermique
Fabriqué en laboratoire
La matrice est colonisée par fibroblaste en 3 semaines
Reconstitue mieux le derme
Greffe
- peau qui adhère sur la plaie induisant une épidermmisation
Lambeau
- peau et muscles vascularisés déplacés d’un endroit à un autre
Attention à la dégénérescence : toute plaie qui ne cicatrise pas depuis longtemps peut être atteint de cancérisation. Faire une biopsie.